Amélie Nothomb
Hygiène de l’assassin
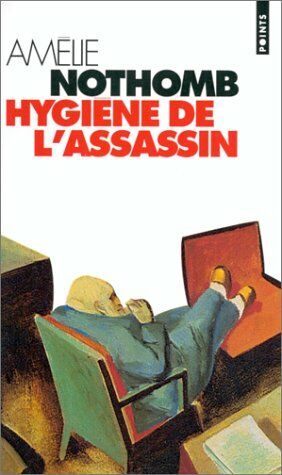
Quand il fut de notoriété publique que l'immense écrivain Prétextat Tach mourrait dans les deux mois, des journalistes du monde entier sollicitèrent des entretiens privés avec l'octogénaire. Le vieillard jouissait, certes, d'un prestige considérable; l'étonnement n'en fut pas moins grand de voir accourir, au chevet du romancier francophone, des émissaires de quotidiens aussi connus que (nous nous sommes permis de traduire) Les Rumeurs de Nankin et The Bangladesh Observer. Ainsi, deux mois avant son décès, M. Tach put se faire une idée de l'ampleur de sa célébrité.
Son secrétaire se chargea d'effectuer une sélection drastique parmi ces propositions: il élimina tous les journaux en langues étrangères car le mourant ne parlait que le français et ne faisait confiance à aucun interprète; il refusa les reporters de couleur, parce que, avec l'âge, l'écrivain s'était mis à tenir des propos racistes, lesquels étaient en discordance avec ses opinions profondes – les spécialistes tachiens, embarrassés, y voyaient l'expression d'un désir sénile de scandaliser; enfin, le secrétaire découragea poliment les sollicitations des chaînes de télévision, des magazines féminins, des journaux jugés trop politiques et surtout des revues médicales qui eussent voulu savoir comment le grand homme avait attrapé un cancer aussi rare.
Ce ne fut pas sans fierté que M. Tach s'était su atteint du redoutable syndrome d'Elzenveiverplatz, appelé plus vulgairement «cancer des cartilages», que le savant éponyme avait dépisté au XIXe siècle à Cayenne chez une dizaine de bagnards incarcérés pour violences sexuelles suivies d'homicides, et qui n'avait plus jamais été repéré depuis. Il ressentit ce diagnostic comme un anoblissement inespéré: avec son physique d'obèse imberbe, qui avait tout de l'eunuque sauf la voix, il redoutait de mourir d'une stupide maladie cardio-vasculaire. En rédigeant son épitaphe, il n'oublia pas de mentionner le nom sublime du médecin teuton grâce auquel il trépasserait en beauté.
A dire vrai, que ce sédentaire adipeux ait survécu jusqu'à l’âge de quatre-vingt-trois ans rendait perplexe la médecine moderne. Cet homme était tellement gras que depuis des années il avouait ne plus être capable de marcher; il avait envoyé paître les recommandations des diététiciens et se nourrissait abominablement. En outre, il fumait ses vingt havanes par jour. Mais il buvait très modérément et pratiquait la chasteté depuis des temps immémoriaux: les médecins ne trouvaient pas d'autre explication au bon fonctionnement de son cœur étouffé par la graisse. Sa survie n'en demeurait pas moins mystérieuse, ainsi que l'origine du syndrome qui allait y mettre fin.
Il n'y eut pas un organe de presse au monde pour ne pas se scandaliser de la médiatisation de cette mort prochaine. Le courrier des lecteurs fit largement écho à ces autocritiques. Les reportages des rares journalistes sélectionnés n'en furent que plus attendus, conformément aux lois de l'information moderne.
Déjà les biographes veillaient au grain. Les éditeurs armaient leurs bataillons. Il y eut aussi, bien sûr, quelques intellectuels qui se demandèrent si ce succès prodigieux n'était pas surfait: Prétextat Tach avait-il réellement innové? N'avait-il pas été seulement l'héritier ingénieux de créateurs méconnus? Et de citer à l'appui quelques auteurs aux noms ésotériques, dont ils n'avaient eux-mêmes pas lu les œuvres, ce qui leur permettait d'en parler avec pénétration.
Tous ces facteurs concoururent à assurer à cette agonie un retentissement exceptionnel. Pas de doute, c'était un succès.
L'auteur, qui avait vingt-deux romans à son actif, habitait au rez-de-chaussée d'un immeuble modeste: il avait besoin d'un logement où tout fût de plain-pied, car il se déplaçait en fauteuil roulant. Il vivait seul et sans le moindre animal familier. Chaque jour, une infirmière très courageuse passait vers 17 heures pour le laver. Il n'aurait pas supporté que l'on fît ses courses à sa place: il allait lui-même acheter ses provisions dans les épiceries du quartier. Son secrétaire, Ernest Gravelin, vivait quatre étages plus haut mais évitait autant que possible de le voir; il lui téléphonait régulièrement et Tach ne manquait jamais de commencer la conversation par: «Désolé, mon cher Ernest, je ne suis pas encore mort.»
Aux journalistes sélectionnés, Gravelin répétait cependant combien le vieillard avait un bon fonds: ne donnait-il pas, chaque année, la moitié de ses revenus à un organisme de charité? Ne sentait-on pas affleurer cette générosité secrète à travers certains personnages de ses romans? «Bien sûr, il nous terrorise tous, et moi le premier, mais je soutiens que ce masque agressif est une coquetterie: il aime jouer à l'obèse placide et cruel pour cacher une sensibilité à fleur de peau.» Ces propos ne rassurèrent pas les chroniqueurs qui, du reste, ne voulaient pas guérir d'une peur qu'on leur enviait: elle leur conférait une aura de correspondants de guerre.
La nouvelle du décès imminent était tombée un 10 janvier. Ce fut le 14 que le premier journaliste put rencontrer l'écrivain. Il pénétra au coeur de l'appartement où il faisait si sombre qu'il mit un certain temps à distinguer la grosse silhouette assise dans le fauteuil roulant, au milieu du salon. La voix sépulcrale de l'octogénaire se contenta d'un «Bonjour, monsieur» inexpressif pour le mettre à l’aise, ce qui crispa le malheureux davantage.
– Enchanté de vous rencontrer, monsieur Tach. C'est un grand honneur pour moi.
Le magnétophone était en marche, guettant les paroles du vieillard qui se taisait.
– Pardon, monsieur Tach, pourrais-je allumer une lumière? Je ne distingue pas votre visage.
– Il est 10 heures du matin, monsieur, je n'allume pas la lumière à cette heure-là. Du reste, vous me verrez bien assez tôt, dès que vos yeux se seront habitués à l'obscurité. Profitez donc du répit qui vous est octroyé et contentez-vous de ma voix, c'est ce que j'ai de plus beau.
– Il est vrai que vous avez une très belle voix.
– Oui.
Silence embarrassant pour l'intrus qui nota sur son carnet: «T. a le silence acerbe. A éviter autant que possible.»
– Monsieur Tach, le monde entier a admiré la détermination avec laquelle vous avez refusé d'entrer à l'hôpital, malgré les injonctions des médecins. Alors, la première question qui s'impose est celle-ci: comment vous sentez-vous?
– Je me sens comme je me sens depuis vingt ans.
– C'est-à-dire?
– Je me sens peu.
– Peu quoi?
– Peu.
– Oui, je comprends.
– Je vous admire.
Aucune ironie dans la voix implacablement neutre du malade. Le journaliste eut un petit rire jaunâtre avant de reprendre:
– Monsieur Tach, je n'userai pas, avec un homme tel que vous, des périphrases qui ont cours dans ma profession. Aussi je me permets de vous demander quelles sont les pensées et les humeurs d'un grand écrivain qui se sait sur le point de mourir.
Silence. Soupir.
– Je ne sais pas, monsieur.
Vous ne savez pas?
– Si je savais à quoi je pensais, je suppose que je ne serais pas devenu écrivain.
– Vous voulez dire que vous écrivez pour savoir enfin à quoi vous pensez?
– C'est possible. Je ne sais plus très bien, je n'ai plus écrit depuis si longtemps.
– Comment? Mais votre dernier roman a paru il y a moins de deux ans…
– Vidange de tiroir, monsieur. Mes tiroirs sont tellement pleins que l'on pourrait éditer un nouveau roman de moi chaque année pendant la décennie qui suivra ma mort.
– C'est extraordinaire! Quand avez-vous cessé d'écrire?
– A cinquante-neuf ans.
– Alors, tous vos romans sortis depuis vingt-quatre ans étaient des vidanges de tiroirs?
– Vous calculez bien.
– A quel âge avez-vous commencé à écrire?
– Difficile à dire: j'ai commencé et arrêté plusieurs fois. La première fois, j'avais six ans, j'écrivais des tragédies.
– Des tragédies à six ans?
– Oui, c'était en vers. Débile. J'ai arrêté à sept ans. A neuf ans, j'ai fait une rechute, qui m'a valu quelques élégies, toujours en vers. Je méprisais la prose.
– Surprenant, de la part d'un des plus grands prosateurs de notre époque.
– A onze ans, j'ai de nouveau arrêté et je n'ai plus écrit une ligne jusqu'à mes dix-huit ans.
Le journaliste nota sur le carnet: «T. accueille les compliments sans se cabrer.»
– Et à dix-huit ans?
– J'ai recommencé. J'écrivais d'abord assez peu, puis de plus en plus. A vingt-trois ans, j'ai atteint ma vitesse de croisière, et je l'ai maintenue pendant trente-six ans.
– Que voulez-vous dire par votre «vitesse de croisière»?
– Je n'ai plus fait que ça. J'écrivais sans cesse; à part manger, fumer et dormir, je n'avais aucune activité.
– Vous ne sortiez jamais?
– Seulement quand j'y étais contraint.
– Au fond, personne n'a jamais su ce que vous avez fait pendant la guerre.
– Moi non plus.
– Comment voulez-vous que je vous croie?
– C'est la vérité. De mes vingt-trois ans à mes cinquante-neuf ans, les jours se sont tellement ressemblés. J'ai de ces trente-six années un long souvenir homogène et quasi dénué de chronologie: je me levais pour écrire, je me couchais quand j'avais fini d'écrire.
– Mais enfin, vous avez subi la guerre comme tout le monde. Par exemple, comment faisiez-vous pour vous ravitailler?
Le journaliste savait qu'il abordait là un domaine essentiel dans la vie de l'obèse.
– Oui, je me souviens avoir mal mangé ces années-là.
– Vous voyez bien!
– Je n'en ai pas souffert. A l'époque, j'étais goinfre mais pas gourmet. Et j'avais d'extraordinaires provisions de cigares.
– Quand êtes-vous devenu gourmet?
– Quand j'ai arrêté d'écrire. Avant, je n'en avais pas le temps.
– Et pourquoi avez-vous arrêté d'écrire?
– Le jour de mes cinquante-neuf ans, j'ai senti que c'était fini.
– A quoi l'avez-vous senti?
– Je ne sais pas. C'est venu comme une ménopause. J'ai laissé un roman inachevé. C'est très bien: dans une carrière réussie, il faut un roman inachevé pour être crédible. Sinon, on vous prend pour un écrivain de troisième zone.
– Ainsi, vous aviez passé trente-six ans à écrire sans discontinuer, et du jour au lendemain, plus une ligne?
– Oui.