Gaston Leroux
Le Coup D’état De Chéri-Bibi
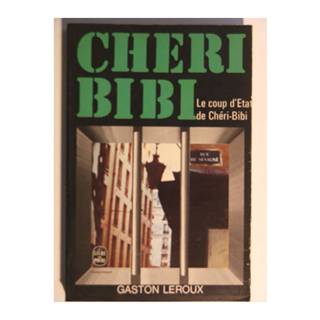
Publié sous le titre Chéri-Bibi, le marchand de cacahouètes en 81 feuilletons quotidiens dans Le Matin, du 16 juillet au 4 octobre 1925, puis en volume en 1926, Librairie Baudinière
I UNE SÉANCE TRAGIQUE
– Demandez les nouvelles de la dernière heure: «La République en danger! Le coup d’État dévoilé! L’interpellation de cet après-midi! La mise en accusation des coupables!»
Les camelots débouchaient au coin des grands boulevards et de la rue Royale.
À la hauteur d’un restaurant où déjeunaient des parlementaires, ceux-ci les appelèrent pour acheter les journaux et rentrèrent hâtivement dans l’établissement où l’on fit groupe autour d’eux.
– Alors, c’est bien pour cet après-midi?
– Mais, je vous l’ai dit: Carlier a les preuves!
– A-t-il les noms?
– Les noms sont dans toutes les bouches!
– Moi, je vous dis que Carlier ne marchera pas. Voilà plus de quinze jours qu’on dit qu’il a les preuves… Il n’a rien du tout! Subdamoun et sa bande sont aussi malins que lui!
– Ils ne sont pas encore devant la Haute-Cour!
– Ils y seront avant huit jours!
– À moins que nous ne les ayons fusillés!
– À moins que le coup d’État n’ait réussi!
– Cette blague! Vous y croyez, au coup d’État! Vous croyez que ça se fabrique comme ça? Tenez! voilà Mulot qui arrive de l’Intérieur… Eh bien! Mulot, avez-vous vu le ministre?
L’interpellé, depuis que presque tous ses amis étaient entrés dans le ministère, un ministère d’extrême-gauche farouche, ne décolérait pas.
Pourtant il avait le gouvernement de son opinion, mais il ne se consolait point de n’en pas faire partie.
Aussi rendait-il la vie dure aux ministres, les poussant aux mesures extrêmes, aux décisions les plus graves, les accusant de manquer de zèle dans l’application des principes et leur portant les ordres menaçants de Carlier qui avait toute l’extrême-gauche dans sa main.
Ah! on était loin de la politique précédente qui déjà avait soulevé tant de colère et autour de laquelle avaient été livrées de si cruelles batailles. Elle eût paru couleur de rose à côté du ministère Hérisson.
Carlier donnait des indications au gouvernement sur les parlementaires à surveiller, dénonçait les citoyens, sans preuve, affirmant qu’il fallait d’abord les arrêter et qu’on trouverait les preuves ensuite! À l’entendre, il n’y avait pas une minute à perdre depuis que les électeurs du neuvième district, en remplacement de leur vieux député réactionnaire, décédé, avaient envoyé à la Chambre ce jeune officier, «le commandant Jacques», «Jacques Ier» comme grondaient ceux qui déjà parlaient de dictature, ou «Subdamoun Ier», en rappel de l’attitude intransigeante de ce soldat, devant la commission de délimitation d’un bout de colonie que la France possédait en Afrique équatoriale. Cette attitude lui avait valu le blâme officiel du gouvernement, à la suite de quoi il avait donné sa démission. Pendant la Grande Guerre, les circonstances avaient fait qu’il avait commandé une division, devenue illustre: la division de fer. Et, depuis, il n’avait cessé de protester contre ce qu’il appelait: le sabotage de la victoire, et il s’était rué dans la politique comme à l’assaut d’une tranchée, prêt à tout nettoyer devant lui.
Peu à peu, une immense popularité l’avait consacré chef de tous les mécontents… et il y en avait!
C’était un noble: marquis, héritier du titre et du nom de Touchais, depuis que son frère aîné, Bernard de Touchais, avait succombé quelques années auparavant dans le tremblement de terre de San Francisco, après avoir à peu près ruiné sa famille. On se rappelle que le père avait fini tragiquement dans l’incendie du château de la Falaise, à Puys, près de Dieppe, incendie qui avait, crut-on alors, dévoré également le fameux Chéri-Bibi, de sinistre réputation.
Mulot consentit enfin à répondre au petit Coudry qui s’était assis à côté de lui.
– Oui, j’ai vu le ministre, je lui ai dit que nous en avions assez. Hérisson a compris. Ça va barder. Nous aurions déjà toute la ficelle du complot depuis longtemps si cet imbécile de Cravely l’avait voulu. Mais Cravely est à la fois, paraît-il, chef de la Sûreté et honnête homme; il aurait reculé devant un cambriolage. Voyez-vous un chef de la Sûreté qui recule devant un cambriolage, quand il s’agit de sauver la République!
Et Mulot cligna de l’œil du côté de Coudry, un gamin rageur que les dernières élections avaient jeté sur les bancs socialistes de la Chambre. Il passait son temps à aboyer aux chausses de tous les orateurs, coupant leurs meilleurs effets, quand ils n’étaient pas de son opinion.
– Savez-vous, reprit Mulot, après un silence, chez qui il a fallu «travailler»?
L’autre prononça un nom à voix basse: «Lavobourg».
Et Mulot fit un signe de tête affirmatif. Lavobourg était le premier vice-président de la Chambre.
– Décidément, il n’y a que de la trahison partout, déclara Coudry.
– Partout!
– C’est donc ça qu’on raconte, que Subdamoun Ier est tout le temps fourré chez l’amie de Lavobourg, la belle Sonia. C’est elle qui a dû remettre à Lavobourg les papiers du Subdamoun pour qu’ils soient plus en sûreté!
Tout ça va éclater dans quelques minutes. Allons, partons! Si Carlier a dit vrai, on va boucler tout le monde. C’est entendu avec le président Bonchamps, qui donnera l’ordre de fermer toutes les portes. Les arrestations auront lieu à la Chambre même. Ah! on va voir la figure des «Subdamoun»! Et le commandant Jacques va en faire une tête quand on le conduira à la Conciergerie.
À l’instant où Mulot et Coudry se disposaient à quitter le restaurant, un de leurs collègues sautait d’un taxi et se précipitait vers eux, les yeux fulgurants. C’était Joly, le questeur.
Il finissait de déjeuner, à la présidence, avec le président Bonchamps, un pur celui-là, un solide, sur qui la révolution pouvait compter, quand Bonchamps, tout à coup, s’était trouvé mal, avait porté les mains à sa poitrine avec un gémissement étouffé, et maintenant il râlait entre les mains des médecins.
– Bonchamps empoisonné! Bonchamps empoisonné!
Ce fut le cri qui se répandit en un instant dans les restaurants de la rue Royale, qui se vidèrent.
La troupe délirante des parlementaires traversait la place de la Concorde et le pont en ramassant sur son chemin les amis qui accouraient en hâte au Palais-Bourbon. Ils apprirent tout de suite que la garde de la Chambre avait été doublée et que les troupes étaient restées consignées dans les casernes, prêtes à tous les événements. Les amis du ministre pouvaient être tranquilles de ce côté depuis qu’Hérisson avait donné le gouvernement militaire de Paris à un civil, le citoyen Flottard, sans la signature duquel le général sous-gouverneur ne pouvait donner un ordre d’importance.